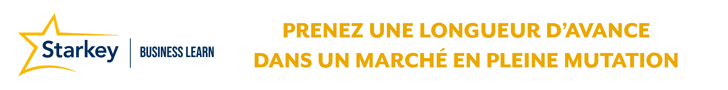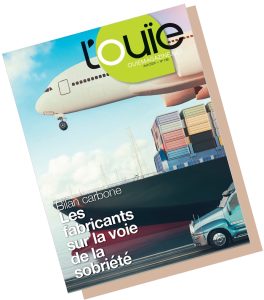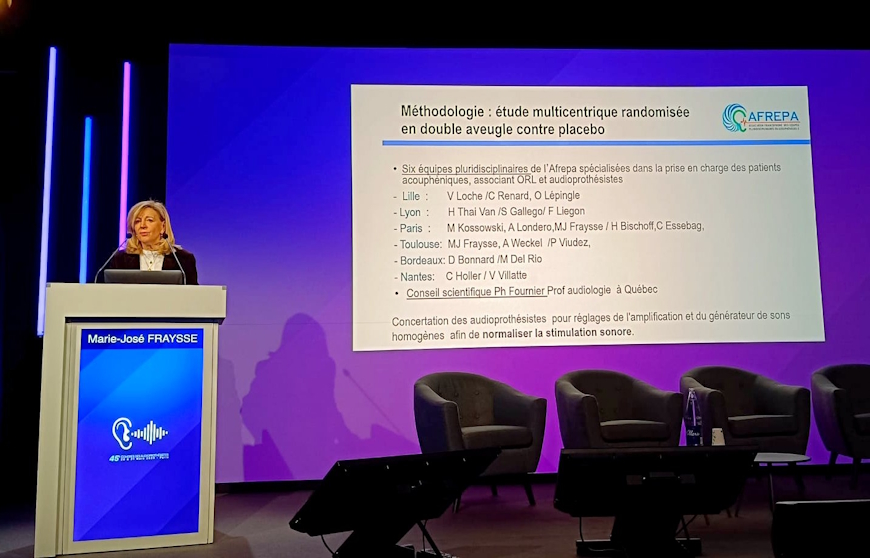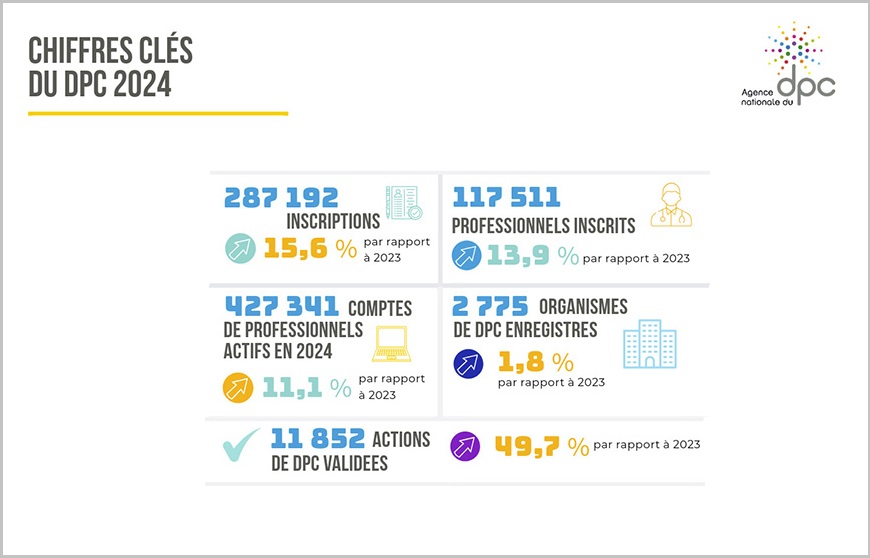Thibaut Gressier, fondateur d’Audiowizard, Brice Jantzem, président du Syndicat des audioprothésistes, Ange-Guy Merdinian, président de Newson, et Matthieu Del Rio, président du Collège national d’audioprothèse lors de la table ronde consacrée aux assistant·es, le 21 mars.
Dédiant une salle du Congrès et une journée à la formation des assistantes, le Syndicat des audioprothésistes a organisé un talk sur leur rôle, central, et ses limites.
« L’assistante est le poumon d’un centre auditif »
« 80 % de nos relations téléphoniques avec les laboratoires sont en réalité avec les assistants, a indiqué Ange-Guy Merdinian, président de Newson, en introduction. Nos catalogues sont essentiellement faits pour eux et nous cherchons à être le plus proches possible : nous répondons et nous renseignons par téléphone… Pour nous l’assistante est le poumon d’un centre auditif. » Ces constatations ont fait l’unanimité des présents. « Bien souvent les assistantes connaissent mieux les catalogues des fournisseurs et des fabricants d’appareils que l’audioprothésiste, a renchéri Brice Jantzem, président du SDA. Il est important que les assistantes puissent voir régulièrement les produits, sur les stands au Congrès ou chez les industriels, car cela fait partie de leur formation continue. »
Bien que leur rôle soit fondamental, aucune formation officielle n’encadre aujourd’hui la formation des assistant·es en audioprothèse, expression que le SDA préfère à toute autre pour bien délimiter ses compétences. A ce propos, Thibaut Gressier, cofondateur d’Audiowizard, a témoigné de ses propres interrogations, en tant que prestataire, sur les limites des rôles de chacun, assistante, audioprothésiste.
Une formation uniformisée, mais laquelle ?
Le SDA a contribué à la création d’ISpe2A, école de formation pour les assistant·es issue d’Audioformea, qui vient de débuter ses activités. « Jusqu’à présent, il n’y avait rien, nous avons abouti à une formation très claire en termes de contenu et de prérogatives », a indiqué Brice Jantzem.
« Le SDA a vraiment eu une bonne idée de mettre en avant la nécessité de structuration de la formation des assistantes et assistants en audioprothèse, a réagi Matthieu Del Rio, président du Collège national d’audioprothèse. C’est, encore une fois, un signe que notre profession a atteint un certain niveau de maturité. Il est nécessaire à la fois d’uniformiser la formation des assistantes et de lui apporter une reconnaissance. Il y a un consensus assez clair sur ce que peut ou ne peut pas faire une assistante. »
Le président du CNA a insisté sur le fait que la Société savante « n’a pas à faire la promotion d’une formation privée, quelle qu’elle soit ». En revanche, elle travaille à la création d’un référentiel de formation dédié aux assistantes. Par le passé, des fiches inscrites au répertoire national des certifications professionnelles ont été déposées, pour la profession d’assistante, mais plus aucune n’est active. Le Collège œuvre donc, avec l’aide de 2 enseignants du Cnam, Eric Bavu et Jean-Baptiste Doc, à la création du référentiel précis de formation et de la fiche RNCP correspondante. Son objectif est d’aboutir à un diplôme universitaire de spécialisation professionnelle (DSP) “Assistant en audioprothèse”, reconnu par l’Etat. « Je pense important que ce type de formation soit portée de manière indépendante et collaborative », a souligné Matthieu Del Rio. Il espère pouvoir annoncer des avancées dans cette entreprise en septembre prochain.
Les lignes rouges
Au fil de la discussion, les représentants du SDA et du CNA ont en effet évoqué différents actes, en tombant d’accord sur le fait de les réserver ou non aux audioprothésistes.
- Les réglages ont été désignés comme la 1ère ligne rouge, ils reviennent bien entendu intégralement aux audios. Brice Jantzem a cependant introduit une nuance : l’assistant·e peut « réinjecter les réglages à l’identique, sans modification, dans un appareil qui revient de réparation ».
- La pratique de l’audiométrie n’a pas fait l’objet d’un débat non plus : elle doit être réservée à l’audioprothésiste. D’autant plus quand, en parallèle, des réflexions avancent sur une éventuelle délégation de tâches entre ORL et audioprothésistes, dans ce domaine. La compétence de l’audioprothésiste doit donc être sanctuarisée (en suivant les dispositions actuelles du code de la santé publique).
- Plus épineux, le sujet des prises d’empreintes. La réglementation actuelle dispose que l’audioprothésiste réalise les actes suivants : « le choix, l’adaptation, la délivrance, le contrôle d’efficacité immédiate et permanente de la prothèse auditive ». Dans une interprétation stricte, seul l’audio devrait pratiquer les prises d’empreintes. Si l’assistante s’y livre, elle expose l’établissement et l’audioprothésiste à un risque juridique en cas d’aléa, si le patient décidait de demander réparation. Pour les scans d’empreintes, à l’inverse, rien ne s’oppose à ce que l’assistante s’en charge.
NB : La prise d’empreintes en vue d’un appareillage auditif est réservée à l’audioprothésiste. Dans un cadre récréatif, il n’y a pas d’encadrement précis quant à la qualité de la personne qui réalise cet acte.
- Autre subtilité : l’assistant·e peut renseigner sur le prix d’un appareil mais c’est l’audioprothésiste qui doit établir le devis, car celui-ci implique un choix d’appareil.
Un consensus et des points à affiner
Pour le président du SDA, la fameuse « ligne rouge » peut se résumer à : toute intervention ayant un impact sur l’acoustique doit être réalisée par l’audioprothésiste. Cela recouvre donc la retouche d’embouts, leur remplacement sauf si c’est à l’exact identique. En miroir, tout ce qui relève de l’entretien de l’appareil (nettoyage, changement de tube…) sans conséquence sur l’acoustique peut être pris en charge par l’assistant·e.
Enfin, certains points ont été plus discutés. L’assistant·e peut-elle réaliser une otoscopie, pour vérifier la présence d’un bouchon ou d’une perforation ? Et passer les appareils sur une chaîne de mesure ? Ces questions reposent celle de la responsabilité juridique. Qui interprète, prend les décisions et doit en répondre en cas de problème ?